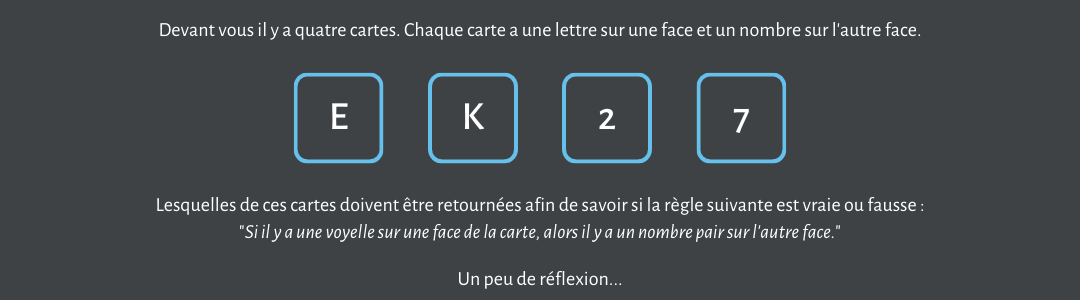Lorsque j’ai commencé à m’intéresser à l’autophagie, je me suis vite rendu compte que ce n’était pas quelque chose de très connu. Sa page wikipédia est assez succincte, certains youtubeurs l’utilisent pour faire des « Top 5 » des maladies mentales les plus curieuses, des sites en aucun cas spécialisés recopient la page wikipédia presque mot pour mot afin de combler un trou dans le planning des publications… Il a donc fallu creuser un peu plus afin de mieux comprendre ce qu’était l’autophagie.
L’autophagie est un comportement qui pousse une personne à « manger » des parts d’elle-même1. Cela va du simple fait de se ronger les ongles jusqu’à se couper des phalanges ou simplement ingérer des morceaux de chair quelconques, du moment que c’est à portée de la bouche. Il ne semble pas, en effet, que les personnes souffrant de ce comportement utilisent autre chose que leur bouche dans ces moments-là, ce qui fait que les extrémités comme les mains et les pieds sont les plus touchés ainsi que les lèvres, intérieures comme extérieures.
Le spectre de l’autophagie est donc assez large et l’on considère alors qu’il y a autophagie dès lors que l’on se ronge les ongles et peaux mortes, ce qui est à ce stade peu inquiétant et assez banal en soit au sein de la population générale. Ce qui commence à devenir inquiétant, c’est lorsque la gravité des blessures grandit, alors que lors de l’acte et après, il n’y a ni culpabilité ressentie ni honte (non pas que ces gens devraient avoir honte, mais cela montre une certaine déconnexion de la réalité quand la personne se coupe des doigts, se fait saigner, etc.). La pulsion qui pousse alors la personne à se mordre est accompagnée au début d’un besoin irrépressible tandis qu’après l’acte il n’y a plus qu’un soulagement et un certain « plaisir ».
Plusieurs impacts qui doivent nous préoccuper sont à noter concernant ce comportement d’automutilation :
- Un impact social : les relations avec autrui peuvent devenir difficiles lorsque l’aspect physique de la personne vient à changer à cause des blessures. Il peut aussi paraître à l’entourage que le comportement est bizarre et inapproprié s’il est effectué en société, provoquant un isolement social (à noter que l’isolement social peut être une des nombreuses causes de ce comportement, ce qui génère un cercle vicieux difficile à briser).
- Un impact médical : une hospitalisation peut être requise dans les cas les plus sévères (hémorragies, infections, naissance d’un handicap, etc.).
- Un impact économique : la personne peut perdre son emploi du fait du handicap occasionné, ou tout simplement du fait que le comportement peut inquiéter l’employeur quant aux responsabilités qu’il peut accorder à son employé… Mais il peut aussi être simplement compliqué de trouver un emploi lorsque l’on présente un aspect qui peut choquer une personne non avertie.
- Un impact psychologique : les rejets subis à cause de ce comportement, comme explicité plus haut, peuvent engendrer un cercle vicieux, accentuant le mal être et le comportement auto-mutilateur.
Le diagnostic concernant l’autophagie est complexe, il n’y a pas vraiment eu de cas observé où une personne ne « pratiquerait » que l’autophagie. C’est pour cela que cette pathologie est associée à d’autres troubles mentaux dans lesquelles elle peut se retrouver, ou alors à l’automutilation au sens large.
Qu’est-ce que l’autophagie sinon une forme d’automutilation comme une autre ?
Un rapprochement avec les troubles du comportement alimentaire pourrait être fait, notamment celui que l’on appelle « pica », le fait d’ingérer des substances non comestibles. Et en effet les causes de l’autophagie, et des automutilations, sont en quelques points similaires à celles des troubles du comportement alimentaire :
- L’apparition du trouble se situe majoritairement dans l’adolescence, avec a priori une prévalence sensiblement similaire chez les garçons et les filles2.
- Les rapports sociaux ont un impact direct sur l’intensité des deux comportements.
- Le développement durant l’enfance explique en partie certains aspects de ces deux troubles (relations conflictuelles avec la famille, maltraitance, abus sexuels, etc.).
- Les deux comportements peuvent aussi être associés à un trouble de la personnalité borderline3, à un trouble obsessionnel compulsif et au syndrome de Gilles de la Tourette4, à une impulsivité particulièrement élevée et à une difficulté majeure dans la gestion des émotions.
Cependant, bien que l’on puisse retrouver chez une même personne des troubles du comportement alimentaire et un comportement d’automutilation, il est assez rare (voire jamais observé ?) de retrouver une personne avec des troubles du comportement alimentaire pratiquer l’autophagie. Il est commun que des personnes dans une telle détresse ait un rapport nocif à la nourriture et qu’ils se fassent du mal, mais jamais en ingérant leur propre chair.
Il semble alors peu probable que l’autophagie se rapproche plus du trouble de l’alimentation que de l’automutilation. C’est même dans cette dernière que l’autophagie se manifeste, et pas l’inverse.
Quelles seraient donc les pathologiques plus probablement à l’origine de l’autophagie ?
Il existe des liens entre ce comportement et la schizophrénie ou un état passager psychotique, mais aussi avec un trouble obsessionnel compulsif, le syndrome de Lesch-Nyhan (qui implique un retard mental) ou une neuropathie diabétique (complication liée au diabète qui implique un endommagement du système nerveux à cause d’un taux de sucre trop élevé sur une durée trop élevée).
Des facteurs sont aggravants dans le comportement d’autophagie, comme l’anxiété sexuelle, un isolement social, l’impulsivité, le stress ou une détresse psychologique quelconque. Bien entendu, tout ces facteurs sont parfaitement subjectifs. Là où un individu peut se sentir complètement isolé socialement, un autre s’y sentirait trop entouré. C’est donc la perception de l’individu qui compte et non pas celle du praticien ou du professionnel qui s’en occupe.
Maintenant que nous avons quelque peu défricher et que l’on comprend mieux comment se manifeste l’autophagie, nous pouvons nous servir du sujet de l’automutilation pour investiguer un peu plus loin, puisqu’il y a encore beaucoup à dire à ce sujet et qu’il nous permettra d’imager un peu mieux ce qui pousse à l’autophagie et comment nous pourrions l’appréhender.
Aborder l’autophagie sous le prisme de l’automutilation nous permet d’élargir les possibilités de causes :
- Trouble de la personnalité borderline.
- Syndrome de Gilles de la Tourette.
- La boulimie (un des nombreux aspects des troubles du comportement alimentaire qui n’exclue évidemment pas que la personne se fasse du mal du fait de son état mental).
- Les troubles du spectre autistique.
- Un retard mental.
- Autres origines neurologiques rares.
- Le harcèlement5 (qu’il soit scolaire, sur internet, ce qu’on appelle le bullying).
Nous pouvons classer ces différents points en différentes catégories :
- Troubles du développement : retard mental, autisme, etc…
- Troubles neurologiques : syndrome de Gilles de la Tourette, épilepsie du lobe frontal, etc…
- Troubles psychiatriques : troubles de la personnalité, certains troubles du comportement alimentaire, schizophrénie, etc..
- Troubles génétiques : syndrome de Lesch-Nyhan, syndrome de Prader-Willi (qui mène à des troubles obsessionnels compulsifs, des crises de colère…), syndrome de Cornelia de Lange (les enfants atteints souffrent d’autisme et ont des comportements autodestructeurs), etc…
On peut donc constater les possibilités qui sont nombreuses et qui rendent un peu plus difficiles les diagnostics. Ce trouble qu’est l’automutilation se manifeste d’abord par une incapacité à résister à l’impulsion, à la suite de quoi survient une tension avant de passer à l’acte. Le plaisir d’avoir réaliser l’acte conclut celui-ci. L’automutilation dont nous parlons n’est pas obligatoirement accompagnée d’idées suicidaires ou qui mènent au suicide, bien qu’elle augmente le risque de celui-ci sur le long terme puisque les automutilation ont tendance à augmenter progressivement en intensité (notamment lorsque la personne n’est pas prise en charge et seule dans sa détresse).
Nous parlerons donc ici d’automutilations non suicidaires, qui est définie comme une blessure infligée à soi-même de manière répétée, qui n’est pas acceptée socialement et qui peut être intentionnelle (bien entendu, nous pouvons toujours débattre de l’intention d’une personne à s’infliger des blessure ou à tenter de se suicider aux vues de son état mental). Comme explicité plus haut, ce comportement apparaît principalement durant l’adolescence6 et tend à diminuer dans les premières années de l’âge adulte.
Quel et le mécanisme qui pousse à ce comportement ?
Une perspective neurobiologique7 nous permet de voir plus précisément ce qui se passe chez certains patients. Il a été observé que l’impulsivité a pu être à l’origine de comportements autodestructeurs (dans le sens où la personne entreprend une action libérée par l’impulsivité, cette dernière n’étant pas à l’origine de la pensée précédant l’acte). Dans plusieurs études8, le fait de cibler certains récepteurs dopaminergiques dans le cerveau avec des antagonistes (généralement des antipsychotiques) a pu se montrer efficace avec des patients tandis qu’avec d’autres patients il a fallu utiliser des agonistes à la noradrénaline pour les mêmes résultats (une origine sûrement différente du comportement autodestructeur ainsi qu’un métabolisme différent, ce genre d’études ne permet pas encore de toucher du doigt le « truc qui cloche » chez tout le monde).
Dans le même esprit, et dans une moindre mesure, agir sur le système opioïde du cerveau a aussi permis de réduire l’impulsivité dans certains cas. Le fait d’agir sur la dopamine, la noradrénaline et les opioïdes, toutes ces molécules étant impliqués dans les comportements d’automutilation9, permet de cerner la complexité de l’origine neurobiologique10 de tels comportements et nous rappelle que bien que certains médicaments peuvent fonctionner, il nous est parfois compliqué d’expliquer comment et pourquoi. Pour finir avec les neurotransmetteurs, la sérotonine quant à elle a une influence sur l’impulsivité en fonction de son taux dans le sang. Plus il y en a, moins il y a d’impulsivité chez la personne.
De nombreux papiers montrent cependant que l’impulsivité, bien qu’elle ait un rôle majeur dans la manifestation du comportement autodestructeur (une sorte de seuil est abaissé par l’impulsivité, augmentant la fréquence des comportements sans en être la cause directe), il ne suffit pas d’agir sur elle pour empêcher l’automutilation.
D’un point de vue psychosocial, il y aurait différentes fonctions11 à l’automutilation, et donc plusieurs origines psychologiques possibles12, ce qui est supporté par cette méta-analyse13 :
- Régulation de l’affect : alléger des affects sévèrement négatifs et alléger l’excitation aversive, réguler le sentiment de honte14.
- Anti-dissociation : faire cesser un état de dissociation ou de dépersonnalisation.
- Anti-suicide : remplacer, compromettre ou éviter l’impulsion de commettre un suicide.
- Affirmer des frontières interpersonnelles : affirmer son autonomie par rapport aux autres distinguer sa personne de celle des autres.
- Influencer les relations interpersonnelles : chercher de l’aide ou manipuler les autres.
- Se punir soi-même : exprimer la colère que l’on a envers soi-même.
- Recherche de sensations : générer de l’excitation, se sentir « vivant ».
Le besoin de contrôle sur de nombreux aspects de sa propre vie semble être un facteur majeur dans le comportement autodestructeur, mais c’est aussi un moyen de communiquer sa détresse et de supporter le stress. Les fonctions les plus souvent rencontrées en clinique sont les fonctions intra personnelles, la régulation de l’affect15 et la punition envers soi-même.
Il existe ensuite plusieurs dimensions composant ce comportement :
- Type d’action : coupure, morsure, brûlure, etc…
- Localisation sur le corps : mains, pieds, tête, etc…
- Fréquence de l’automutilation : tous les jours/semaines/mois, etc…
- Gravité des dégâts : contusions, saignements, etc…
- Etat psychobiologique au moment du passage à l’acte : retard mental, autisme, etc…16
- Fonction de l’automutilation : interpersonnelle, intrapersonnelle (voir plus haut les fonctions décrites)…
Deux points sont importants à souligner avant d’aborder les différents traitements proposés et efficaces à ce jour. Le seuil de tolérance à la douleur et le stress ressenti. Il a été découvert chez les personnes pratiquant l’automutilation que leur seuil de tolérance à la douleur est plus élevé. De la même manière qu’une tolérance plus forte à l’alcool peut pousser à boire plus, le fait de moins ressentir la douleur peut pousser à aller plus loin dans la blessure qu’on s’inflige. Nous l’avons vu plus haut, le contrôle de ses émotions et de sa vie plus largement peut pousser à l’acte autodestructeur, le fait de moins ressentir la douleur est donc un facteur aggravant. Un point rassurant, lorsque l’on arrive à réduire en fréquence ces actes, le seuil revient à la « normale ».
Concernant le stress, il peut influencer la perception de la douleur. Celle-ci est une information traitée dans le cerveau et la douleur effectivement subie et la manière dont on la ressent sont deux choses séparées. Le stress peut induire une analgésie (le fait de ne plus ressentir de douleur) ou une hyperalgésie (le parfait contraire, ressentir la douleur de façon décuplée pour un même stimulus, tout se passe dans l’interprétation).
Cette réponse au stress altérée viendrait d’un développement perturbé dans l’enfance par des abus, de la maltraitance et de la négligence. On retrouve là le même pattern à l’origine de beaucoup d’autres troubles.
Comment pouvons nous aider ces personnes au mieux ?
Comme nous en avons déjà discuté, les cas les plus sévères d’autophagie, et d’automutilation plus largement, sont presque toujours (si ce n’est à chaque fois, mais je n’ai pas la connaissance de toutes les études faites sur le sujet, je n’en ai simplement pas trouvé) associés à une autre pathologie. Il semble donc primordial lorsque l’on envisage un traitement, d’identifier toutes les comorbidités et d’agir en fonction de la singularité biologique et psychologique de chacun. Les causes et origines de ce trouble étant nombreuses, les possibilités de traitement le sont tout autant, que ce soit par le biais de médicaments ou de psychothérapie.
Au niveau des psychothérapies, une de celles ayant le plus montré d’efficacité est la thérapie comportementale dialectique17, notamment utilisée pour les troubles de la personnalité borderline18, parfois associés à un syndrome de stress post-traumatique19 et testée chez les adolescents s’automutilant, avec ou sans troubles associés20. De plus, adapter la thérapie aux enfants semble montrer des résultats intéressants dans le cadre des automutilations sans intention suicidaire21. Les effets bénéfiques venant de cette thérapie se font ressentir rapidement après le début du suivi autant par la personne prise en charge que sa famille. Cette thérapie consiste en partie à s’accepter tel que l’on est et à en faire de même pour l’environnement qui nous entoure22, sans pour autant se « laisser aller » dans celui-ci. Les comportements autodestructeurs diminuent significativement, la régulation émotionnelle se fait plus facilement et la dépression s’estompe. Bien sûr il n’est pas exclu qu’en parallèle des thérapies soient utilisés des médicaments.
Cette thérapie combine l’entraînement à la prévention de la réponse à une exposition néfaste (stress ou n’importe quel stimulus non souhaité), à la gestion de ses émotions, à la résolution de problèmes, des stratégies de modifications cognitives avec pleine conscience, validation et acceptation par rapport à l’environnement et à sa propre personne. Cette thérapie est d’ailleurs indiquée pour le trouble du stress post-traumatique, qui est une des possible comorbidités chez les personnes qui s’automutilent.
Les thérapies cognitives et comportementales, notamment la thérapie de résolution de problèmes, sont d’une efficacité non négligeable23 mais pas encore assez significative dans leurs résultats24. La thérapie de groupe et le MACT (Manuel-Assisted Cognitive-behavioral Therapy) ont aussi peiné à obtenir une efficacité significative dans l’amélioration des symptômes des patients, la psychothérapie dynamique déconstructive n’a pas réussi à faire mieux.
Pour finir avec les thérapies, les interventions cognitives et comportementales brèves25 ciblant deux compétences, que sont la conscience émotionnelle et la réévaluation cognitive, qui ont une action sur les processus fonctionnels qui maintiennent les patients dans l’automutilation, permettent de réduire cette dernière et sa fréquence ainsi que son intensité.
Et les médicaments ?
Les traitements médicamenteux sont divers et variés en raison des origines multiples du trouble. Les antipsychotiques atypiques comme l’aripiprazole (agoniste et antagoniste partiel des récepteurs dopaminergiques et serotoninergiques) ont montré des résultats intéressants, comme le naltrexone (un inhibiteur des opioïdes) ainsi que les inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine (surtout utilisés pour la dépression, l’anxiété ou les troubles obsessionnels compulsifs, ils augmentent les taux de sérotonine dans le cerveau)26.
Il n’est pas rare que les gens aient peur des médicaments ou considèrent que les patients ne s’en portent que mieux sans ceux-ci, mais il est une réalité à entendre qui est que certains patients ont un besoin vital d’avoir accès à ces médicaments. Cela n’est certes pas un remède miracle et cela peut ne pas fonctionner du premier coup (voire pas du tout), obligeant les médecins à changer plusieurs fois, donnant une impression d’incompétence, mais chaque personne étant en possession d’un métabolisme bien particulier, c’est une nécessité.
Une combinaison de médicament approprié avec psychothérapie adaptée permet d’aider au mieux les patients. Cela concerne les médecins comme les psychiatres et psychologues, mais qu’en est-il des éducateurs et enseignants, que faire lorsque l’on est confronté à un cas d’automutilation, potentiellement de l’autophagie, sans être un professionnel de santé ?
Le simple fait de savoir l’essentiel de ce qui compose le trouble permet déjà d’élaborer des pistes de travail. Bien entendu, il y a diverses gravités possibles et il peut y avoir un moment, une limite, à partir de laquelle il devient impossible d’aider l’autre, mais jusque là il faut s’y atteler. Valoriser la personne, lui donner un certain contrôle sur sa vie et son environnement, la réintégrer socialement, l’inclure scolairement, réparer le tissu familial… Il y a de nombreuses façons de travailler d’une manière purement sociale et éducative en parallèle du traitement médical et de la psychothérapie, et la personne en face de nous, ce qu’elle est, définit une grande part de ce qui sera mis en place pour l’amener à reprendre une place à part entière dans la société.
Sources utilisées :
[1] Michopoulos, I., Gournellis, R., Papadopoulou, M., Plachouras, D., Vlahakos, D. V., Tournikioti, K., … Lykouras, L. (2012). A Case of Autophagia. The Journal of Nervous and Mental Disease, 200(2), 183–185. doi:10.1097/nmd.0b013e318243989b
[2] Lewis, S. P., & Heath, N. L. (2015). Nonsuicidal Self-Injury among Youth. The Journal of Pediatrics, 166(3), 526–530. doi:10.1016/j.jpeds.2014.11.062
[3] Santangelo, P. S., Koenig, J., Funke, V., Parzer, P., Resch, F., Ebner-Priemer, U. W., & Kaess, M. (2016). Ecological Momentary Assessment of Affective and Interpersonal Instability in Adolescent Non-Suicidal Self-Injury. Journal of Abnormal Child Psychology, 45(7), 1429–1438. doi:10.1007/s10802-016-0249-2
[4] Hood, K. K., Baptista-Neto, L., Beasley, P. J., Lobis, R., & Pravdova, I. (2004). Case Study: Severe Self-injurious Behavior in Comorbid Tourette’s Disorder and OCD. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 43(10), 1298–1303. doi:10.1097/01.chi.0000134492.80925.96
[5] Brunstein Klomek, A., Snir, A., Apter, A., Carli, V., Wasserman, C., Hadlaczky, G., … Wasserman, D. (2016). Association between victimization by bullying and direct self injurious behavior among adolescence in Europe: a ten-country study. European Child & Adolescent Psychiatry, 25(11), 1183–1193. doi:10.1007/s00787-016-0840-7
[6] Brown, R. C., & Plener, P. L. (2017). Non-suicidal Self-Injury in Adolescence. Current Psychiatry Reports, 19(3). doi:10.1007/s11920-017-0767-9
[7] Groschwitz, Rebecca C., et Plener, Paul L., « The Neurobiology of Non-suicidal Self-injury (NSSI): A review », Suicidology Online, 2012, pp. 24-32.
[8] Pattij, T., & Vanderschuren, L. J. M. J. (2020). The Neuropharmacology of Impulsive Behaviour, an Update. Current Topics in Behavioral Neurosciences. doi:10.1007/7854_2020_143 ;
Pattij, T., & Vanderschuren, L. (2008). The neuropharmacology of impulsive behaviour. Trends in Pharmacological Sciences, 29(4), 192–199. doi:10.1016/j.tips.2008.01.002
[9] Tiefenbacher, S. (2005). The physiology and neurochemistry of self-injurious behavior: a nonhuman primate model. Frontiers in Bioscience, 10(1-3), 1. doi:10.2741/1500
[10] Westlund Schreiner, M., Klimes-Dougan, B., Begnel, E. D., & Cullen, K. R. (2015). Conceptualizing the neurobiology of non-suicidal self-injury from the perspective of the Research Domain Criteria Project. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 57, 381–391. doi:10.1016/j.neubiorev.2015.09.011
[11] Klonsky, E. D. (2007). The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clinical Psychology Review, 27(2), 226–239. doi:10.1016/j.cpr.2006.08.002
[12] Claes, L., & Vandereycken, W. (2007). Self-injurious behavior: differential diagnosis and functional differentiation. Comprehensive Psychiatry, 48(2), 137–144. doi:10.1016/j.comppsych.2006.10.009
[13] Taylor, P. J., Jomar, K., Dhingra, K., Forrester, R., Shahmalak, U., & Dickson, J. M. (2018). A meta-analysis of the prevalence of different functions of non-suicidal self-injury. Journal of Affective Disorders, 227, 759–769. doi:10.1016/j.jad.2017.11.073
[14] Schoenleber, M., Berenbaum, H., & Motl, R. (2014). Shame-related functions of and motivations for self-injurious behavior. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5(2), 204–211. doi:10.1037/per0000035
[15] Cullen, K. R., Westlund, M. K., LaRiviere, L. L., & Klimes-Dougan, B. (2013). An Adolescent With Nonsuicidal Self-Injury: A Case and Discussion of Neurobiological Research on Emotion Regulation. American Journal of Psychiatry, 170(8), 828–831. doi:10.1176/appi.ajp.2013.12121598
[16] Minshawi, N. F., Hurwitz, S., Morriss, D., & McDougle, C. J. (2014). Multidisciplinary Assessment and Treatment of Self-Injurious Behavior in Autism Spectrum Disorder and Intellectual Disability: Integration of Psychological and Biological Theory and Approach. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(6), 1541–1568. doi:10.1007/s10803-014-2307-3
[17] Chapman AL. Dialectical behavior therapy: current indications and unique elements. Psychiatry (Edgmont). 2006 Sep;3(9):62-8. PMID: 20975829; PMCID: PMC2963469.
[18] Fleischhaker, C., Böhme, R., Sixt, B., Brück, C., Schneider, C., & Schulz, E. (2011). Dialectical Behavioral Therapy for Adolescents (DBT-A): a clinical Trial for Patients with suicidal and self-injurious Behavior and Borderline Symptoms with a one-year Follow-up. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 5(1), 3. doi:10.1186/1753-2000-5-3
[19] Harned, M. S., Korslund, K. E., & Linehan, M. M. (2014). A pilot randomized controlled trial of Dialectical Behavior Therapy with and without the Dialectical Behavior Therapy Prolonged Exposure protocol for suicidal and self-injuring women with borderline personality disorder and PTSD. Behaviour Research and Therapy, 55, 7–17. doi:10.1016/j.brat.2014.01.008
[20] Mehlum, L., Tørmoen, A. J., Ramberg, M., Haga, E., Diep, L. M., Laberg, S., … Grøholt, B. (2014). Dialectical Behavior Therapy for Adolescents With Repeated Suicidal and Self-harming Behavior: A Randomized Trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 53(10), 1082–1091. doi:10.1016/j.jaac.2014.07.003
[21] Perepletchikova, F., Axelrod, S. R., Kaufman, J., Rounsaville, B. J., Douglas-Palumberi, H., & Miller, A. L. (2010). Adapting Dialectical Behaviour Therapy for Children: Towards a New Research Agenda for Paediatric Suicidal and Non-Suicidal Self-Injurious Behaviours. Child and Adolescent Mental Health, 16(2), 116–121. doi:10.1111/j.1475-3588.2010.00583.x
[22] Lynch, T. R., Chapman, A. L., Rosenthal, M. Z., Kuo, J. R., & Linehan, M. M. (2006). Mechanisms of change in dialectical behavior therapy: Theoretical and empirical observations. Journal of Clinical Psychology, 62(4), 459–480. doi:10.1002/jclp.20243
[23] Washburn, J. J., Richardt, S. L., Styer, D. M., Gebhardt, M., Juzwin, K. R., Yourek, A., & Aldridge, D. (2012). Psychotherapeutic approaches to non-suicidal self-injury in adolescents. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 6(1), 14. doi:10.1186/1753-2000-6-14
[24] Glenn, C. R., Franklin, J. C., & Nock, M. K. (2014). Evidence-Based Psychosocial Treatments for Self-Injurious Thoughts and Behaviors in Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 44(1), 1–29. doi:10.1080/15374416.2014.945211
[25] Bentley, K. H., Nock, M. K., Sauer-Zavala, S., Gorman, B. S., & Barlow, D. H. (2017). A functional analysis of two transdiagnostic, emotion-focused interventions on nonsuicidal self-injury. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 85(6), 632–646. doi:10.1037/ccp0000205
[26] Turner, B. J., Austin, S. B., & Chapman, A. L. (2014). Treating Nonsuicidal Self-Injury: A Systematic Review of Psychological and Pharmacological Interventions. The Canadian Journal of Psychiatry, 59(11), 576–585. doi:10.1177/070674371405901103