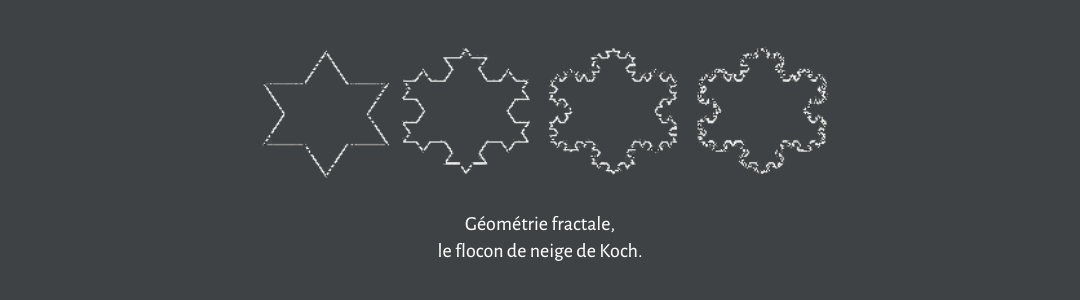Pickard, H. (2020). What we’re not talking about when we talk about addiction. Hastings center report, 50(4), 37-46.
[lien pour télécharger l’étude]
Traduction de l’introduction de l’article.
Pendant une dizaine d’années, j’ai travaillé en tant qu’assistant thérapeute d’équipe à temps partiel dans une communauté thérapeutique du National Health Service pour des personnes souffrant de troubles de la personnalité et de besoins complexes, dont beaucoup luttaient contre diverses formes d’addiction. Les communautés thérapeutiques sont des environnements de soins particuliers : contrairement aux contextes de soins de santé plus conventionnels, tant au Royaume-Uni qu’aux États-Unis, elles sont informelles et non hiérarchiques et nécessitent des relations personnelles (bien que professionnelles) authentiques et soutenues entre les cliniciens et les patients, ainsi qu’entre les patients eux-mêmes. Bien que les médicaments fassent partie du traitement lorsqu’ils sont appropriés, ce sont les relations qui sont considérées comme les médiateurs cruciaux du changement cognitif, émotionnel et comportemental des patients et qui font donc partie intégrante du succès thérapeutique. L’expérience de me retrouver à travailler en tant que philosophe dans un contexte clinique très particulier et de devoir apprendre à partir de zéro comment établir des relations efficaces avec les membres de mon groupe afin de bien faire mon travail est au cœur de ma compréhension de la dépendance. Cependant, je ne suis que trop consciente du fait que je commence cet essai en décrivant qui je suis et la genèse de mes recherches, non seulement par souci d’orientation, mais aussi parce que ce que je veux dire est controversé. En effet, d’après mon expérience, ces propos sont souvent accueillis avec une sorte d’indignation dans le contexte américain, comme s’ils témoignaient d’une incapacité totale à comprendre la dépendance et à se soucier des personnes qui y sont confrontées.
Je pense que la dépendance est un état très hétérogène qui n’est pas correctement expliqué par le modèle actuellement dominant, qui la considère comme une maladie neurobiologique chronique et récurrente caractérisée par une consommation compulsive en dépit des conséquences négatives. La raison fondamentale de mon désaccord avec ce modèle est que la dépendance est mal caractérisée par une consommation compulsive, mais cette évaluation a des implications potentielles pour l’affirmation selon laquelle la dépendance est, dans tous les cas, une maladie du cerveau. Dans l’ensemble, la consommation de drogues dans l’ad-diction reste orientée vers un objectif : les gens prennent des drogues, même dans l’addiction, parce que les drogues ont une valeur énorme. On ne saurait trop insister sur l’importance de ce point. Pour aider une personne à surmonter sa dépendance, vous devez comprendre pourquoi elle persiste à consommer des drogues malgré les conséquences négatives. Si elle n’y est pas contrainte, l’explication doit porter sur la valeur de la drogue pour elle en tant qu’individu. Par conséquent, pour l’aider, vous devez reconnaître ensemble cette valeur et y remédier d’une manière ou d’une autre, afin que l’équilibre entre les avantages et les coûts apparents de la consommation change pour l’individu, dans l’immédiat et à plus long terme.
Pourquoi ce point de vue est-il accueilli avec indignation ? Je crois qu’elle cache une peur sous-jacente. Cette crainte est que, si nous n’insistons pas sur un modèle de maladie neurobiologique de la compulsion, nous risquons de revenir à un modèle moral de la dépendance. Le modèle moral comporte deux parties. La première partie affirme que la consommation de drogues est un choix, même pour ceux qui sont dépendants. La seconde partie est la condamnation morale de ce choix : les toxicomanes sont des personnes de mauvaise moralité qui embrassent une vie d’hédonisme. Mais nous ne sommes pas obligés de choisir entre ces modèles. Il existe une alternative claire : nous pouvons reconnaître le choix tout en maintenant les soins et en combattant le moralisme à l’égard des drogues. En effet, personne ne peut regarder quelqu’un lutter contre la dépendance et penser que l’explication est que cette personne a adopté une vie d’hédonisme – un fêtard dionysiaque qui ne voit aucune raison de changer. Quel que soit le plaisir que procurent les drogues, vivre avec une dépendance, c’est vivre avec la souffrance.
L’indignation peut également protéger contre une douleur sous-jacente. À ce stade de notre histoire, la plupart d’entre nous connaissent des personnes qui luttent contre la dépendance, et beaucoup d’entre nous connaissent des personnes qui en sont mortes. La souffrance que cela entraîne n’est que trop réelle, et elle inclut souvent la reconnaissance du fait que les drogues ont une valeur pour les personnes dépendantes, même aux dépens d’autres choses auxquelles elles accordent également une valeur réelle, comme l’amour. Si la compulsion était une caractérisation appropriée, cela rendrait tout cela moins douloureux. Mais en connaissant et en soignant des personnes qui luttent contre la dépendance, il est difficile de ne pas voir que, quelle que soit la vérité de l’idée de compulsion, ce n’est pas toute l’histoire.
Nous nous accrochons donc au mythe de la compulsion causée par une maladie du cerveau comme une sorte de mécanisme de défense psychologique – pour essayer d’éviter notre peur de la condamnation morale et de la douleur. Mais la réalité est que nous ressentons la douleur de toute façon. Et la véritable source de la propension à la condamnation morale ne se trouve pas chez les personnes qui luttent contre la dépendance, mais chez nous – avec notre volonté de sauter sur l’occasion de condamner et de blâmer et notre refus de reconnaître collectivement notre propre rôle dans la création d’une société où les conditions de la dépendance prospèrent.
[…]